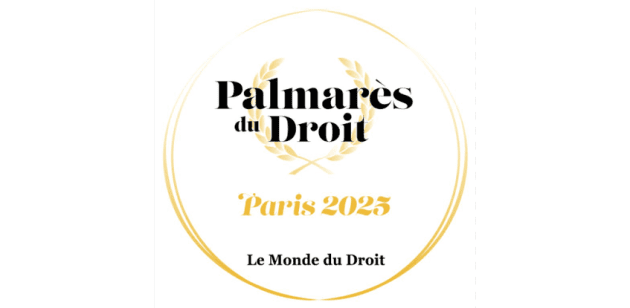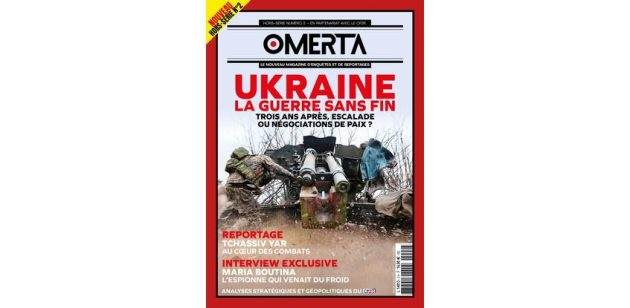La prétendue responsabilité « délictuelle » pour rupture brutale de relations commerciales établies

Un temps discuté en doctrine, la nature de la responsabilité encourue pour rupture brutale de relations commerciales établies paraît scellée par la Cour de cassation depuis 2008 : celle d’une responsabilité délictuelle spéciale. La jurisprudence la plus récente manque pourtant de cohérence, voire en contredit le postulat. Elle fait songer que « la rupture brutale est avant tout la méconnaissance d’une obligation contractuelle spécifique », celle instaurée par l’article L. 442-1, II, du Code de commerce et qu’il ne peut donc s’agir que d’un cas spécial de responsabilité contractuelle.
1. Toute entreprise qui reçoit des services ou se fait livrer en France des biens par un fournisseur depuis plusieurs années doit prendre conscience que dans l’hypothèse où elle résilie son contrat ou en refuse le renouvellement, elle s’expose à verser à ce fournisseur une indemnité en application de l’article L. 442-1, II, du Code de commerce. Ce texte issu de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 et remplaçant l’ancien article L. 442-6, I, 5°, du même code, dispose en effet qu’« engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ».
2. Depuis une quinzaine d’années, la chambre commerciale de la Cour de cassation affirme avec la plus grande constance que cette responsabilité, née de la rupture brutale de relations commerciales établies, revêt une nature délictuelle, « extracontractuelle » devrait-on dire depuis la réforme du droit des obligations par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Force est néanmoins d’observer au fil des années et des arrêts que cette assertion prétorienne se délite progressivement. Des décisions refusent d’engager à titre subsidiaire la responsabilité délictuelle de droit commun de l’auteur de la rupture (I), ce qui eût pourtant été cohérent si l’article L. 442-1, II, du Code de commerce érigeait un cas de responsabilité délictuelle spéciale. D’autres admettent même à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de droit commun de l’auteur (II) ; autant de décisions qui, finalement, invitent à recevoir le postulat inverse, celui d’une responsabilité contractuelle spéciale (III).
I – Le refus d’admettre à titre subsidiaire la responsabilité délictuelle de droit commun
3. S’il s’agissait, d’emblée, d’une responsabilité délictuelle spéciale, prévue par un texte spécifique, à savoir l’article L. 442-1, II, le plaideur pourrait invoquer subsidiairement les dispositions de la responsabilité extracontractuelle du droit commun, celle fondée sur la faute (C. civ/, art. 1240, al. 1er), pour voir ses prétentions aboutir. Or, la Cour de cassation considère que « les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, étant exclusives de celles de l’article 1382, devenu 1240 du Code civil, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu qu’en l’absence de toute faute délictuelle distincte établie, la demande fondée sur ce dernier texte devait être rejetée ». Si l’assimilation semble faite de la rupture brutale à une « faute délictuelle », l’arrêt ferme expressément les vannes du recours subsidiaire à la responsabilité extracontractuelle. Il exige la preuve d’une « faute délictuelle distincte » laquelle, par hypothèse, ne peut exister dans le cadre de relations commerciales par nature contractuelles. De pure forme, la réserve faite à la démonstration d’une telle faute dissimule mal que la responsabilité délictuelle de droit commun est une voie sans issue pour le plaideur. En outre, si de responsabilité délictuelle spéciale il était véritablement question, le contractant victime de cette rupture brutale ne devrait pas pouvoir invoquer, dans son assignation ou ses conclusions en demande, les dispositions relatives à la violation d’un contrat source de responsabilité contractuelle. Le principe, bien assis en jurisprudence comme en doctrine, du « non-cumul » des responsabilités contractuelle et délictuelle proscrirait l’option entre ces demandes.
4. Et, pourtant, la chambre commerciale de la Cour de cassation juge l’inverse. Ce principe, réplique-t-elle, « interdit seulement au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n’interdit pas la présentation d’une demande distincte, fondée sur l’article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce, qui tend à la réparation d’un préjudice résultant non pas d’un manquement contractuel mais de la rupture brutale d’une relation commerciale établie ». En somme, le contractant échaudé peut invoquer la responsabilité contractuelle de l’auteur de la rupture sur le fondement du droit commun des contrats (C. civ., art. 1231-1), comme celle issue du texte du Code de commerce. Preuve en est fournie par un autre arrêt qui, au visa de l’ancien article 1149 du Code civil, statue sur une demande d’indemnisation de « rupture brutale » d’un contrat de distribution agréé de former elle-même au visa des articles 1134 et 1147. Ces trois décisions, totalement inintelligibles si l’article L. 442-1 organisait une responsabilité délictuelle spéciale, ne se comprennent en réalité que si l’on postule que ce texte organise une responsabilité contractuelle spéciale.
(…)
L’article complet est accessible en suivant ce lien : La prétendue responsabilité « délictuelle » pour rupture brutale de relations commerciales établies
Dernières publications
EQA Avocats accompagne Pozzi Milano S.p.A. dans l’acquisition d’une participation majoritaire de Venditio SAS
Après de longs mois de négociations, la société italienne Pozzi Milano SPA, spécialisée dans la production d’articles d’art de la table, a acquis 90 % du capital social de Venditio SAS, son agent commercial pour la France et la Belgique. Au 21 mars 2025, la transaction était finalisée. L’acquisition des 10 % restants du capital… Continue reading EQA Avocats accompagne Pozzi Milano S.p.A. dans l’acquisition d’une participation majoritaire de Venditio SAS
EQA Avocats récompensé au Palmarès Le Monde du Droit 2025
Pour la première fois, EQA Avocats a participé au classement des cabinets d’avocats organisé par Le Monde du Droit, et a eu l’honneur de recevoir deux distinctions dans la catégorie des cabinets de moins de 10 avocats : • Private Equity – Or • Fusions-Acquisitions < 50 millions d’euros – Bronze Ces récompenses sont le… Continue reading EQA Avocats récompensé au Palmarès Le Monde du Droit 2025
Retour sur le colloque du Master 212 de l’Université Paris Dauphine – Un débat d’experts sur la dédollarisation
Le 13 mars 2025, le Master 212 de l’Université Paris Dauphine a organisé son colloque annuel, consacré cette année à un sujet stratégique : « Dédollarisation : le monde peut-il tourner sans dollar ? BRICS et dollar : l’hégémonie américaine remise en question« . Parmi les experts invités, Maître Étienne Épron, associé gérant du cabinet EQA Avocats… Continue reading Retour sur le colloque du Master 212 de l’Université Paris Dauphine – Un débat d’experts sur la dédollarisation
Sanctions : quand la lutte pour « nos valeurs » piétine « nos valeurs »
Etienne Epron a publié le 5 mars 2025 une tribune dans le magazine Omerta dont nous reproduisons ci-dessous le texte. Les trains de sanctions successifs pris par l’UE à l’encontre de la Russie sont inédits par leur ampleur. Ces sanctions touchent aussi bien des entités publiques et privées que des particuliers. Problème : tant leur teneur… Continue reading Sanctions : quand la lutte pour « nos valeurs » piétine « nos valeurs »